En début d’année, le club de basketball de Poitiers (PB86) lançait sa chaîne Twitch, dans le sillage d’autres clubs sportifs français qui ont déjà emboité le pas dans cette direction. Une plateforme sociale qui est en essor depuis quelques temps, à tel point que les médias traditionnels commencent à y être présents. L’essor des plateformes sociales concourt en partie à la marchandisation des loisirs, où un lien économique est créé entre les créateurs et leurs abonnés.
À l’inverse des travailleurs des plateformes évoqués dans l’article précédent, les travailleurs des plateformes sociales ont la particularité d’être visibles, et c’est même tout le but recherché. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, pour ne citer que les plus célèbres : sur celles-ci, c’est un véritable capital communautaire, issu des interactions de proximité entre le travailleur et ses abonnés, qui s’élabore et est développé au travers d’une présence régulière. Par exemple, sur Twitch, un streamer ne se contente pas de jouer : il commente la partie en cours, interagit avec d’autres joueurs, lit les réactions dans le chat et les commente. Il remercie également ceux qui s’abonnent et font des dons, et crée des icônes, les émotes, accessibles seulement pour ses abonnés. Tout cela contribue à créer une apparence d’intimité partagée et une appartenance à une communauté spécifique avec ses codes. Cette intimité instrumentalisée est au cœur de la relation économique entre le streamer et ses abonnés. Les mêmes ressorts de ce capital communautaire se retrouvent sur les plateformes Twitter, Instagram, Facebook, où il est possible d’interagir avec le créateur de contenus. Mais, bien entendu, tout le monde ne part pas avec le même capital communautaire : celui-ci est d’autant plus grand que le créateur a déjà constitué une audience sur un service tiers.
Comme les autres plateformes, celles dites sociales contribuent à la redéfinition des frontières du travail : est-ce du travail ou du loisir ? La plateforme Youtube y participe fortement et s’intègre dans le capitalisme attentionnel où « le seul fait de regarder un objet constitue un travail qui accroît la valeur de cet objet » selon Citton. Tout pousse l’utilisateur à consommer toujours plus de contenus et la structure de la plateforme incite à créer un profil, centralisateur de données personnelles, pour pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités de Youtube. La transformation de ce travail en valeur se quantifie par les nombres de vues et d’abonnés, marqueurs de réputation non seulement pour les créateurs de contenus mais aussi pour les annonceurs. Ces mêmes abonnés garantissent aux créateurs des revenus stables, notamment via les plateformes de dons telles que Tippeee et Utip, là où la monétisation de Youtube est très fluctuante et peu rétribuante (là où un influenceur Instagram sera rétribué en placement de produits). Cette communauté de fans est essentielle pour les vidéastes, en vue de permettre la circulation des vidéos et ainsi l’accroissement de leur audience, participant ainsi à ladite communauté et à la création de valeur. Dans cet esprit, la communauté est ainsi l’ensemble des travailleurs réunis autour d’un vidéaste et de sa chaîne Youtube. Tout comme les streamers sur Twitch, les vidéastes de Youtube peuvent partager leur notoriété en mettant en avant d’autres créateurs : ces pratiques sont très fréquentes chez les vidéastes travaillant dans la vulgarisation au sens large, par exemple.
Les plateformes sociales, bien plus que tout autre plateforme numérique, jouent du brouillage entre travail et loisir : l’offre gratuite donne l’illusion que le travail des créateurs serait gratuit, de l’ordre du loisir. Le ressort de la passion peut être sincère, et pousse le créateur à être d’autant plus actif. Pourtant, les nouveaux travailleurs hors-statut des plateformes doivent consacrer du temps, acheter ou emprunter du matériel, l’entretenir pour assurer leur niveau de vie. Là où les plateformes sociales tendant à faire croire qu’il est possible de réussir à partir de quasiment rien, c’est une réelle professionnalisation des créateurs de contenus sur les plateformes sociales qui est à l’œuvre : ainsi, peu de créateurs en font leur métier à plein temps, et leur statut est souvent précaire pour la majorité. C’est le hope labor, ce travail gratuit réalisé dans l’espoir d’une situation plus stable qui caractérise fortement les plateformes sociales.
Ainsi, il n’est pas surprenant qu’un community manager, salarié remunéré pour participer à l’animation cadrée des réseaux sociaux d’une structure, soit une figure stable : il se trouve en-dehors des logiques de risques et de volatilité propre à l’auto-entreprenariat, et cela est donc plus facile pour lui de pratiquer de la gestion de communauté. Le facteur « chance » l’emporte ainsi sur le facteur « mérite », et ce sont les facteurs matériels qui conditionnent ce dernier. Pour les plateformes avares de données personnelles et aux conditions générales d’utilisation défavorables aux utilisateurs, il s’agit d’externaliser les coûts appliqués au travail en lui-même, pour en tirer plus de plus-value sans grand frais. Les créateurs et les utilisateurs n’ont aucun pouvoir sur les algorithmes de ces plateformes, et la rétribution des premiers est en tributaire. Garantir un statut professionnel stable pour les créateurs, leur permettant ainsi de déployer toutes leurs potentialités, irait pleinement dans le sens de la démarchandisation des loisirs.
Ces plateformes font une éditorialisation croissante des contenus, et ce tout en se parant de l’attribut de simple hébergeur. Il s’agit de mettre en avant les contenus qui ont potentiellement la plus grande propension à être viraux, et que l’algorithme mettra ensuite en avant auprès des utilisateurs. Mais pour exister de manière visible sur les plateformes sociales, il faut investir même la somme la plus mince : du temps, voire de l’argent. Dans le même temps, la viralité propre à ces plateformes peut être très aléatoire, et là encore ce sont ceux qui détiennent un capital communautaire déjà conséquent qui seront mis en avant par la plateforme. Faire un tweet, un post, un contenu est pensé dans le sens de la viralité, de pouvoir être repris largement et voir les autres abonder dans son sens. C’est par la même occasion un fonctionnement en silos qui en découle, où les affinités d’opinions modèlent les abonnements. Le modèle économique de ces plateformes sociales n’est pas étranger à cela : tout est fait pour agréger le plus de vues sur les contenus hébergés, et ainsi adosser des contenus publicitaires qui permettent aux plateformes de générer des revenus conséquents.
Ainsi, rompre avec les logiques délétères des plateformes sociales suppose une rupture avec le modèle économique qui y est adossée. En plus de promouvoir une marchandisation des relations sociales et des loisirs, ces plateformes sociales sont dans leur fonctionnement même anti-démocratique. Dire cela, ce n’est pas nier la libération de la parole qui s’y joue. L’algorithme va dans le sens du biais de confirmation, au lieu de travailler à la mise en opposition et discussion d’opinions divergentes. Tout le sens du dépassement de telles plateformes au travers de la création de nouvelles, c’est avant tout une reprise en main des utilisateurs sur l’algorithme, avec la possibilité d’amender ce dernier pour l’améliorer continuellement. L’ère des GAFA n’est pas vouée à être éternelle : il est possible de prendre un autre chemin.
Jérémy Roggy

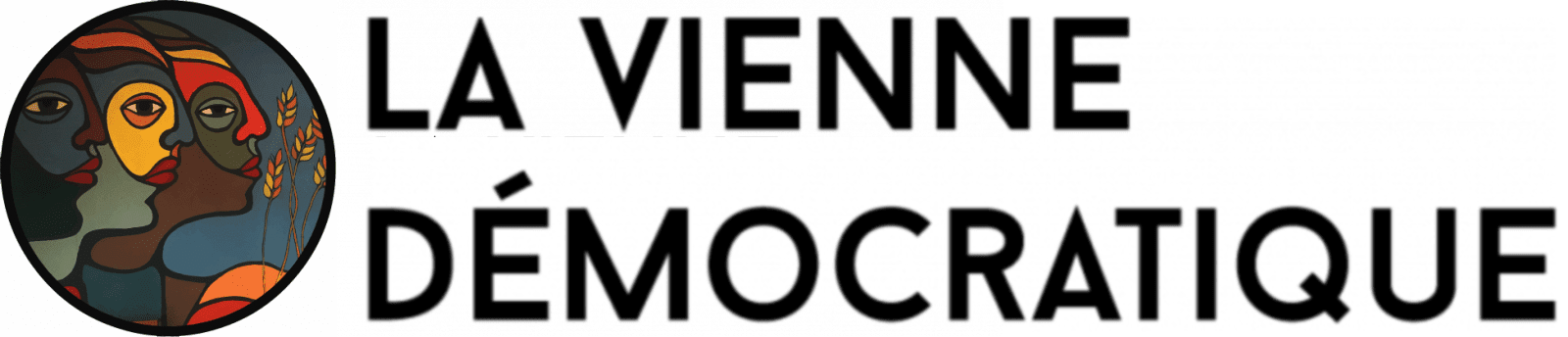

[…] Publié initialement sur La Vienne Démocratique […]