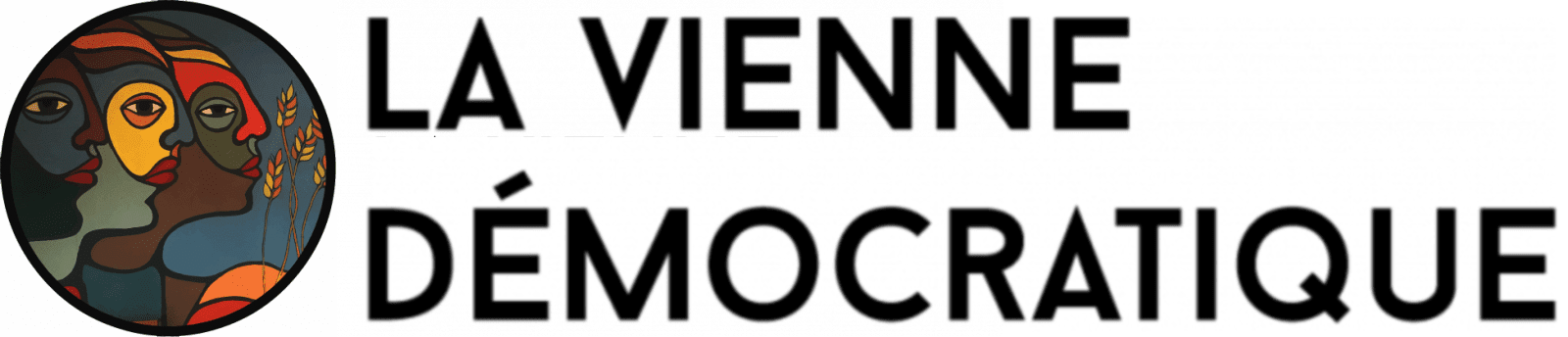Alors que les plans sociaux dans l’industrie s’amoncèlent dans le pays comme dans la Vienne, alors que l’avenir des fonderies du Poitou est en grand danger… on entend régulièrement chez les politiques qui s’expriment au sujet de ces difficultés – bien souvent organisées dans le but de produire la même chose ailleurs à bas coût – évoquer l’idée que les emplois industriels pourraient être remplacés par des “activités écologiques”, sans qu’on ne sache vraiment bien de quoi on parle. Une fausse contradiction, réduite aux techniques de production ou même aux produits, est insinuée entre écologie et industrie La Vienne démocratique propose un autre regard.
Le réchauffement climatique est une réalité largement étayée par les scientifiques, forts de données et études détaillées. Depuis la fin du 19ème siècle, la Terre ne cesse de voir sa température globale augmenter de manière rapide par rapport à l’ère préindustrielle. En cause, l’augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l’atmosphère qui retiennent les rayons infrarouges émis par le Soleil. L’ère moderne, structurée par le capitalisme, est résolument basée sur les ressources fossiles : gaz, charbon, pétrole. L’enjeu est donc de taille : il s’agit de renouveler des pans entiers de l’industrie, de l’économie, basées sur ces ressources qui permettent leur fonctionnement. Et il n’est pas dit que les alternatives actuelles soient nécessairement moins problématiques. Il y a également l’enjeu de l’accès aux ressources naturelles nécessaires au fonctionnement des industries, et de fait de leur disponibilité. Les changements qui s’imposent sont donc structurels : ils appellent à une nouvelle organisation de l’industrie dans ses ressources, ses usages, ses finalités. Néanmoins, ces changements nécessaires se heurtent à des freins majeurs. Mais beaucoup de ceux qui les dénoncent et appellent au changement sont mus par une idéologie fataliste qui élude les causes réelles de la crise actuelle.
Les industries centrales sont dans leur écrasante majorité sous l’égide de trusts capitalistes, et elles demandent une structuration particulière qui requiert un apport de capitaux important que leurs détenteurs cherchent d’une manière ou d’une autre à faire fructifier, sous la forme de profits présents et futurs. Cela amène trop souvent en premier lieu à une critique de l’industrie en elle-même, au lieu d’une critique des trusts capitalistes. Cela entraîne aussi parfois une critique envers les salariés qui font vivre ces industries, qui prennent toute leur place dans les rapports de production, qui font pleinement partie des forces productives des industries. Ces mêmes salariés qui “choisissent” plus ou moins d’y participer, en vendant leur force de travail, en y déployant leurs capacités physiques et intellectuelles au service de la production. L’industrie n’est pas une généralité idéalisée mais un ensemble d’organisations sociales rationalisées qui centralisent les forces productives (nature, travail, outils et machines) pour créer des productions pour la société, dans le cadre de la propriété privée des moyens de production sous le régime du capitalisme. L’industrie est résolument une force sociale qui a la capacité de transformer et reconfigurer la nature, à l’aide des sciences qui constituent l’étude et la connaissance de la réalité objective.
L’écologie politique se concentre essentiellement sur les finalités de la production industrielles : pollutions environnementales, impact sur la biodiversité et les milieux naturels, impact sur la santé humaine. Elle dénonce à juste titre les effets délétères d’une production anarchique. Mais trop souvent, elle confond l’industrie et le capitalisme, remettant sur la première les actes de ce dernier. Elle amène à une individualisation des responsabilités portées quant à ces effets. Les salariés seraient ainsi fautifs. Les citoyens devraient faire le travail de changement que ceux en responsabilités, c’est-à-dire les propriétaires des entreprises industrielles, ne veulent pas engager. Cela se décline de deux manières : un rejet des industries classiques, un accent mis sur les actes écoresponsables. L’écologie politique fait alors vivre une idéologie fataliste : quoi qu’il arrive, le réchauffement climatique est implacable, il sera d’autant plus fort car ceux qui tiennent les industries font des efforts limités. Dans ce cadre, chacun est renvoyé à un appel à l’action qui semble vain : recycler ses déchets, réduire ses consommations d’eau et d’énergie, en bref une certaine sobriété. Si l’impact n’est pas nul, cela ne saurait éluder le poids réel de l’industrie : ainsi, lors du confinement de début 2020, la consommation énergétique à l’échelle nationale et mondiale avaient considérablement chuté avec la mise à l’arrêt des industries et la limitation des transports.
Si le réchauffement climatique semble implacable, avec la perspective d’ici 2100 d’une hausse pouvant aller jusqu’à 5°C et des conséquences désastreuses, c’est parce que les détenteurs des entreprises ne veulent pas rogner sur leurs profits. La recherche de profits se heurte de manière contradictoire à la marche des sciences et des techniques : les capitalistes ont besoin d’outils et de machines toujours plus perfectionnés, de salariés toujours plus qualifiés pour pouvoir produire mieux et plus, mais ces besoins sont extrêmement coûteux, et de fait ils cherchent à les réduire pour maximiser leurs gains sur le court-terme et le long-terme. Le sous-financement de l’éducation et de la recherche scientifique est la marque d’une crise du système capitaliste. L’éducation et la recherche sont perçues comme un luxe, et on leur demande l’efficacité d’une entreprise privée. Une éducation et une recherche hautement financées ne sont pas envisageables sur le long-terme en régime capitaliste. Le fatalisme de l’écologie politique est fondé sur un manque criant de remise en cause radicale du système économique et social actuel qui est intrinsèquement injuste et inégalitaire. On ne peut investir sur l’avenir si on reste dans le cadre de la propriété privée des moyens de production.
La rupture avec le capitalisme ne signifie pas un retour à la « nature ». Même les tenants de l’écologie politique sont pour une société avancée et démocratique. Dans un cadre de dépassement du capitalisme, le travail reste le centre des activités humaines, la transformation de la nature reste incontournable pour répondre aux besoins de la société. Mais cela ne se fera pas sans une démocratisation des entreprises, sans une rupture avec la propriété privée des moyens de production qui impose depuis trop longtemps aux forces productives des schémas de production foncièrement anarchiques et irrationnels sur le court-terme et sur le long-terme. Dégager l’industrie de la structuration capitaliste qui la corsète depuis plusieurs siècles est indispensable pour espérer engager une libération de la recherche scientifique et de l’éducation. Il est clair que les rapports sociaux qui existent dans l’industrie se déploient dans les secteurs de la recherche scientifique et de l’éducation, et ce qui est appelé communément « management néolibéral » n’est que le reflet de cela. Permettre aux travailleurs de libérer leurs potentiels, c’est permettre à toute la société de se déployer dans ce qu’elle a de plus positif. Comme l’écrivait Joë Metzger en 1974 dans son livre Pour la science, « avec la révolution scientifique et technique, nous voyons naître de manière embryonnaire les forces productives de la société communiste ». Cette révolution porte en elle « l’exigence d’une transformation sociale plus radicale ». Dans cette perspective, on ne peut pas penser l’avenir de l’humanité sans l’industrie.
Jérémy Roggy