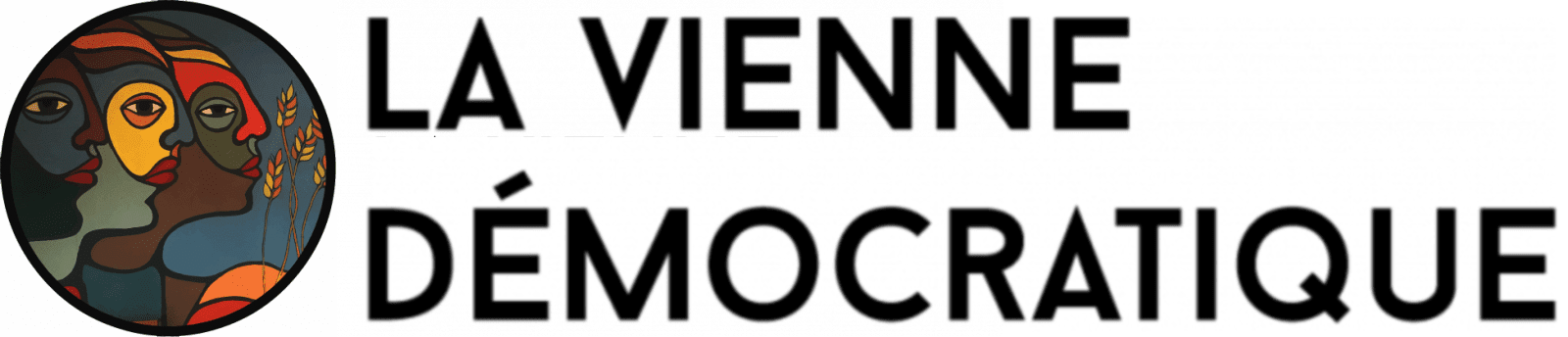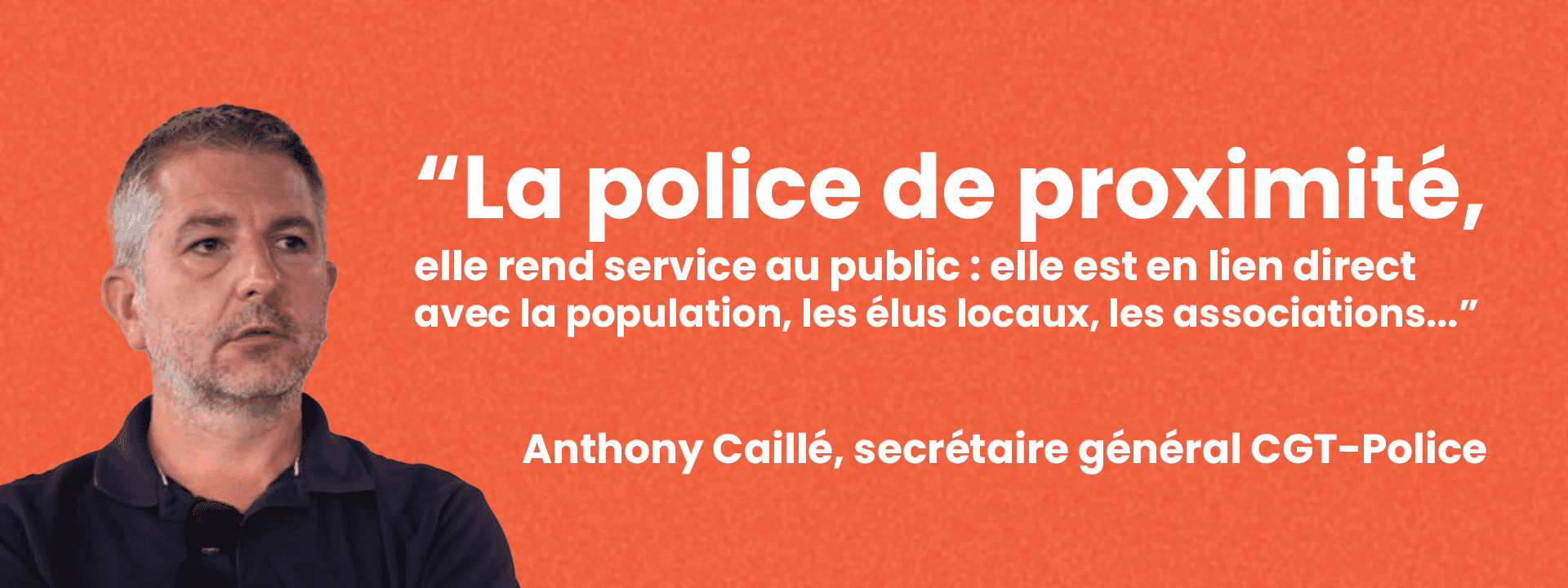Anthony Caillé est secrétaire général du syndicat CGT-Police, il était à Poitiers le 13 novembre dernier, invité par les Jeunes Communistes de la Vienne. Notre rédaction en a profité ! Les propos ont été recueillis par Maxime C. et Christophe Sicot.
M.C : Quels sont les particularités du syndicalisme policier ?
A.C. : D’abord, le syndicalisme policier est hypertrophié, on ne trouve pas de chiffres officiels mais on estime que 70% des policier·es sont syndiqué·es. La seconde particularité c’est que c’est un syndicalisme catégoriel en plus de professionnel, chaque grade a son syndicat les commissaires ont leurs syndicats, les officier·es aussi et les gardien·nes de la paix également. Ces trois syndicats ne se mélangent pas entre eux et même si ils sont confédérés, ils ont très peu de liens et d’interactions avec leurs confédérations et sont des syndicats “autonomes” de fait. La CGT police ne pratique pas ça et s’organise sans échelon catégoriel et en fort lien avec la confédération.
Ces syndicats autonomes font un syndicalisme de service et assurentiel, le ministère de l’Intérieur leur a, très officieusement, confié les clefs de la cogestion sur l’avancement et les mutations : il est compliqué pour un·e policier·e de partir de Paris pour aller à Biarritz mais ce sera plus dur encore sans l’appui du syndicat.
“La syndicalisation est une étape quasi incontournable chez les flics.”
Même chose pour l’avancement, malgré un examen interne réussi, la promotion n’est pas garantie : la réussite de l’examen, même si obligatoire, ne détermine pas l’obtention d’un poste, cette promotion n’aura lieu qu’avec l’aval du chef de service et des syndicats. Ça amène à une particularité, si un syndicat comme Alliance classé très à droite revendique 40% des effectifs de policier·es syndiqué·es chez eux, ce qui est colossal, il est possible que l’immense majorité des policiers syndiqué·es chez eux ne le soient non par adhésion idéologique mais surtout pour obtenir leur mutation, leur avancement et pour le logement, parce que ces syndicats vont également négocier les logements sociaux au sein du ministère de l’intérieur. La syndicalisation est une étape quasi incontournable chez les flics.
M.C. : Dans un complément d’enquête on peut voir des bons de réduction dans un hypermarché obtenus par Alliance, ça s’ajoute au logement mais là on est très loin de la conception du syndicalisme qu’on a par exemple à la CGT.
A.C : Ce syndicalisme de service va plus loin même, si à la CGT la cotisation est de 1% du salaire net, chez Alliance la cotisation annuelle oscille entre 80 et 130 euros (donc nettement moins de 1%) mais si un couple adhère en même temps au syndicat, la cotisation est encore moins chère. Si la première adhésion est à 100 euros on peut voir la seconde à 50 euros. Alliance roule sur l’or, 22 000 adhérents à 100 euros c’est déjà quelque chose mais comme ils trustent la moitié des sièges au CSA ministériel, ils ont des dotations supplémentaires alloués par nombre de siège et elle est calculée en fonction du nombre de salariés dans un ministère, plus un ministère est gros et a de fonctionnaires, plus y’a d’argent pour les syndicats représentatifs. C’est pas le cas de la CGT Police, nous on a que les cotisations des adhérent·es. Mais tout ça rajoute une couche pour montrer le corporatisme dans toute sa splendeur qu’est le syndicalisme policier aujourd’hui, c’est une étape indispensable et un policier profondément républicain voir de gauche peut se retrouver à Alliance juste pour s’en sortir : je connais personnellement des policier·es qui vont voter à gauche mais qui sont à Alliance ou à Unité.
M.C : C’est quoi ta vision de la police de demain ?
“L’idée principale, qui est ni neuve ni révolutionnaire, c’est déjà d’avoir une masse salariale qui soit à la hauteur d’un service public de police”
A.C : On a tellement massacré les services publics en France que ma réponse va pas être très révolutionnaire, la révolution ce serait déjà de revenir à la police qu’on avait y’a 20 ans. Là on est tellement en souffrance, de réforme en réforme. J’ai fait parti de ceux·celles qui fin des années 90 début des années 2000 pensaient que l’état dézinguait les services publics mais qu’il ne toucherait pas à la Police Nationale, grave erreur : ils nous sont tombés dessus après les autres, on commence là à vivre les conséquences des réformes mises en place sous Sarkozy et Hollande dans le cadre de la “modernisation de l’action publique”, le non-remplacement d’un·e fonctionnaire sur deux, on y a pas échappé. Les préfet·es aussi sont devenu·es, plus que des représentants de l’État, ils·elles sont devenu·es des VRP (ndlr : des commerciaux) de l’État : dans leur feuille de route, ils·elles ont cette mission d’aller vendre de la vidéo-surveillance et de la police municipale aux mairies en l’échange de subventions de l’État. Ces “contrats locaux de sécurité”, même si le nom change tous les six moi ça consiste en un contrat entre la préfecture et les maires en expliquant que si un poste de police municipal est ouvert, que de la vidéo-surveillance est installée, l’État financera une partie du dispositif mais charge à la collectivité territoriale de le gérer ensuite. Ça peut aller jusqu’à la promesse de renfort de Police Nationale en échange d’un commissariat municipal.
Sauf qu’en réalité, dès que le commissariat de police municipale est ouvert, la préfecture ferme des postes dans le commissariat de Police Nationale. Les missions sont de plus en plus envoyées dans les commissariats de police municipale (jusqu’à demander aujourd’hui à ce que certain·es policier·es municipaux aient la qualité d’officier de police judiciaire donc puissent placer en garde-à-vue) malgré les baisses de subventions aux mairies. En gros, la réalité c’est que dès qu’un commissariat de police municipale ouvre, un commissariat de Police Nationale ferme. Sauf que cette police municipale ne remplace pas la police de proximité, qui était précieuse parce qu’en la perdant on a perdu deux choses. D’abord on a perdu la mission qui était centrale, et ensuite on a perdu les effectifs, soit 30 000 postes de PN en moins. Les chiffres avancés par les ministres successifs de 140 ou 160 000 policiers sont faux, le nombre d’inscrit·es aux élections professionnelles est de 111 000. Quand je suis rentré en poste en 1998 on était 146 000, c’est une chute colossale. Du coup l’idée principale, qui est ni neuve ni révolutionnaire, c’est déjà d’avoir une masse salariale qui soit à la hauteur d’un service public de police, qui permette la remise en place d’une police de proximité, de faire machine arrière sur le massacre de la police judiciaire par Darmanin.
“En plus on commence à mettre les quelques douaniers qui restent sur des questions de migrations, alors que c’est pas leur métier.”
La PJ c’est hyper important, la plupart des faits divers concernent aujourd’hui le trafic de stupéfiants mais si il y’a du trafic c’est que les fonctions régaliennes de l’état sont abandonnées. D’une part, il n’y a plus de douaniers ni de contrôle aux frontières de marchandises et d’autres part il n’y a plus de police judiciaire pour s’attaquer à la criminalité organisée, on se contente de faire du saute-dessus et des opérations places nettes XXL ça ne fait que taper sur des petits dealeurs, laissant les têtes de réseaux tranquille. Pour illustrer la perméabilité des frontières vis-à-vis des marchandises, la CGT douane estime que pour 100kg de résine de cannabis saisis, une tonne passe. En plus on commence à mettre les quelques douaniers qui restent sur des questions de migrations, alors que c’est pas leur métier. La police de proximité, c’est une police qui rend service au public, elle circule à pied dans tous les quartiers de la ville, elle est en lien direct avec la population, les élus locaux, les associations, les commerces et les autres services publics, mais ceux-là n’existent plus non-plus.
Il faut que le policier soit au cœur de la ville, il doit faire de la prévention toute la journée, c’est le cœur de son travail même si il a aussi sa casquette répressive. Je ne nie pas la partie répressive de la mission du policier mais la priorité doit toujours être la prévention, mais là problème : la prévention ça ne se quantifie pas vu qu’on ne peut pas rendre de chiffres. Comme aujourd’hui on est contraints par la politique du chiffre et les primes qui en dépendent, personne ne fait de prévention. Cette culture du résultat est le fruit du capitalisme et on y échappe pas.
M.C : Tu nous a parlé de la réforme de la police judiciaire, est-ce que tu peux développer là dessus ? Faut-il une police dépendante du ministère de la justice ?
A.C : On ne peut pas réduire la PN a une entité, donc on ne peut pas mettre toute la police sous la tutelle du ministère de la justice. La prévention, la tranquillité publique c’est de l’ordre du ministère de l’intérieur. La police judiciaire c’est différent, l’enquêteur de la PJ il a deux chefs : il a son chef administratif, son chef de service qui est un policier (commissaire ou directeur) mais dans ses enquêtes, que ce soit en préliminaire, en flagrant délit ou en commission rogatoire, son chef c’est le magistrat, juge d’instruction ou procureur de la République, là y’a une dualité forte entre la justice qui souhaite que les OPJ enquêtent, ce qui demande des moyens humains comme financiers, il faut des flics mais aussi des bagnoles, des billets de train, d’avion etc. Par exemple quand on fait de la téléphonie ou des réquisitions, c’est payant : un opérateur téléphonique facture le ministère, et c’est très très cher.
Une enquête judiciaire sur du crime organisé ça coute énormément de fric, sauf que admettons, j’ai besoin de ma voiture, j’ai des suspects à Marseille, il faut qu’on parte 3 jours en voiture et à trois policier·es. Le magistrat va approuver mais ensuite le commissaire va répondre : vous partez pas à trois, vous irez à deux et une seule journée. On est confronté·es tout le temps à ces problèmes là, qui nous freinent dans les enquêtes de fond. À noter que les commissaires de police l’ont très mauvaise de pas avoir la main sur ces choses là, un des revendications de leur syndicat c’est d’avoir la main sur les enquêteurs, de pouvoir orienter et diriger les enquêtes, aujourd’hui c’est théoriquement pas possible mais ils le font par le biais des moyens alloués. Faut pas oublier que ce commissaire c’est aussi celui qui note l’OPJ, lui donne ses journées de congés, valide la promotion, ordonne les permanences, signe les chèques etc. C’est le commissaire qui fait la carrière du policier.
C.S : Est-ce que c’est la même chose pour les gendarmes ?
A.C : Je connais moins la situation de la gendarmerie mais les gendarmes se dotent de services d’enquête même si jusqu’ici la gendarmerie n’avait pas de corps particulier de police judiciaire. Sans cracher sur la gendarmerie, ils ont beaucoup de retard là dessus, ils essaient, la guerre des services elle existe et ça donne des trucs lunaires : pendant que Darmanin flingue la PJ, la gendarmerie se dote d’une “direction nationale de la police judiciaire” interne à la gendarmerie.
C.S : C’est quoi l’intérêt politique de Darmanin, alors ministre de l’intérieur, de s’attaquer à la Police Judiciaire ?
“Un·e enquêteur·ice de PJ qui s’occupe de criminalité organisée peut se retrouver à surveiller une manif organisée au hasard par des JC bruyant·es, sans jamais avoir été formé au maintien de l’ordre ou au contact.”
A.C : La politique du chiffre : ça permet de réinjecter les effectifs dans les commissariats et de traiter tous les dossiers de basse intensité et de faire du chiffre mais c’est aussi politique, en créant la Direction Départementale de la Police Nationale, Darmanin a crée un échelon qui a autorité sur le commissariat mais aussi les renseignements, la police aux frontières et la police judiciaire. Il n’y’a que la sécurité intérieure et les CRS qui sont indépendants. Par exemple un·e enquêteur·ice de PJ qui s’occupe de criminalité organisée peut se retrouver à surveiller une manif organisée au hasard par des JC bruyant·es, sans jamais avoir été formé au maintien de l’ordre ou au contact. Et ce·tte DDPN, il·elle n’est plus directement sous l’autorité de la Direction Générale de la Police Nationale mais dépendant des ordres du·de la préfet·te. Ça pose un vrai problème notamment concernant les affaires de probité, par exemple si on décide de bétonner un front de mer, c’est à la préfecture de donner les autorisations. Ça va être très compliqué si l’inspection du travail ou le ministère de l’environnement trouve un problème dans les travaux, l’enquêteur peut se voir interdire d’enquêter par la préfecture ! On ne peut pas prouver de volonté politique à soumettre la PJ aux préfets derrière cette création mais en tout cas, la PJ est plus dépendante du pouvoir politique.
M.C : Est-ce qu’il n’y a pas une volonté, en ne s’attaquant plus aux réseaux sur le fond mais en faisant du chiffre de se nourrir électoralement en créant des circonstances favorables au trafic pour mieux s’en plaindre et justifier le tout répressif ?
A.C : C’est pire que ça : quand Darmanin appelle le commissaire pour lui dire “demain matin on fait une opération place nette” qu’est-ce qu’il se passe ? Le commissaire va voir les enquêteurs des stupéfiants, qui ont des dossiers sur le long terme, parfois six mois de travail et leur demande tel ou tel dossier. Forcément les flics protestent, ce type d’opération sabote le travail sur le long terme et on aura pas la tête de réseau. On a perdu des dizaines de dossiers comme ça et les moyens que ça implique.
C.S : Comment ça se fait que la CGT Police représente si peu au sein de la PN ?
Y’a plusieurs choses dans l’histoire de la police qui justifie ça, déjà un clair abandon de la gauche mais si on remonte en 1946, la fédération de la Police qui détient quasiment tous les syndicats de policiers adhère à la CGT, ça fait 90 000 policiers à la CGT. En 1948, Jules Moch, ministre socialiste de l’intérieur fait la chasse aux sorcières et révoque 600 policiers de la CGT dont l’essentiel étaient des anciens des FFI. Après ça il reçoit les syndicats, il leur dit “vous avez une profession particulières, vous êtes des hommes particuliers il est hors de question que vous vous organisiez dans un syndicat d’ouvriers, je ne traiterai avec les syndicats de policiers que s’ils sont autonomes, si vous restez à la CGT je continue, en gros, de vous taper dessus”. Le plus gros syndicat de la fédération, Unité de l’époque, le bureau national du SGP est constitué uniquement de socialistes et de communistes, la création des CRS les communistes y prennent toute leur part, c’est pour ça que la CGT y était encore très forte jusqu’il y a une 20 aine d’années.
En 1948 donc, les syndicats décident de quitter la CGT, quelques camarades restent mais la majorité s’en va, comme à l’époque la CGT pèse 5.5 millions d’adhérent·es, le départ de 90 000 policiers ça soulève pas les foules. Aujourd’hui tout le monde s’en bouffe les doigts parce qu’avec la centralisation autour du ministère de l’intérieur, si la représentativité de la CGT passe de 2 à 6%, elle explose sur le total. Pareil pour le PCF, on s’est concentré sur l’éducation ou la santé, ce qui est normal mais on a abandonné la sureté publique.
“Le jour on a une CGT forte dans la police, on aura une police différente”
C.S : Je pense qu’il faut pas qu’on abandonne cette idée de tranquillité publique, sinon on la laisse à la droite voire à l’extrême-droite et ils en font n’importe quoi.
A.C : Je suis d’accord, je dis toujours que le jour on a une CGT forte dans la police, on aura une police différente, mais pour ça il faut également qu’on ait un vrai débat sur le fond de ce qu’on veut collectivement.